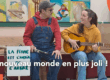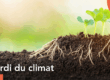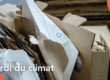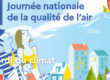Quand on évoque la biodiversité, on pense bien souvent aux oiseaux et aux mammifères, moins fréquemment aux poissons, et encore plus rarement aux insectes. Ce sont pourtant ces derniers qui auront l’honneur de notre actualité sur le sujet des liens entre biodiversité et changement climatique, dont ils sont eux aussi les victimes.
Saviez-vous que les populations d’insectes ont diminué de 70 à 80 % dans les paysages européens agro-industriels, comme le montrent de nombreuses études menées durant ces dix dernières années ?
En 2022, dans le journal Ecological Monographs, les scientifiques ont par exemple établi que “ »e par leur petite taille et leur incapacité à réguler leur température corporelle, les insectes s’avèrent particulièrement sensibles aux changements environnementaux comme la température et l’humidité ».
Le réchauffement climatique affecte déjà des plantes et des animaux, et de manière irrémédiable pour certaines espèces ; les insectes sont eux aussi durement impactés. Les vagues de chaleur ou de froid, les sécheresses, les excès de précipitations et les incendies peuvent faire disparaître localement certaines espèces d’insectes.
En 2023, à Besançon, la 3e édition des Assises nationales des insectes pollinisateurs avait veillé à sensibiliser élus et grand public à l’effondrement de ces populations essentielles à la vie humaine. C’est grâce aux pollinisateurs que 9 plantes à fleurs sur 10 sont présentes sur notre planète. Or, ces plantes, dans une grande majorité, sont une source de nourriture pour les êtres humains ; elles fournissent en effet des acides aminés, des oligoéléments, des fibres, bref, des éléments que l’on trouve dans les fruits et légumes.
Outre la production alimentaire, la pollinisation permet également le brassage génétique des plantes.
Maillon fort de la chaîne alimentaire
Il n’est pas inutile de rappeler que les insectes jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire, et servent eux-mêmes de nourriture aux oiseaux, aux mammifères, aux reptiles, aux invertébrés…
Et que dire de leur rôle dans la vie de nos sols ? Certains insectes se sont spécialisés dans la décomposition et le recyclage des de la matière organique ou encore l’aération du sol. Ils constituent des auxiliaires indispensables à la bonne santé de nos sols.
Le déclin des insectes fait partie du déclin global de la biodiversité, avec plus d’un million d’espèces menacées d’extinction à brève échéance, selon le dernier rapport de l’IPBES (1). Cette crise d’extinction représente un des enjeux majeurs pour les humains, aux côtés du changement climatique.
On se rend compte alors que la diminution des insectes a des conséquences en chaîne et touche de façon plus ou moins directe l’ensemble du vivant. Le changement climatique, les pollutions, la bétonisation, l’agriculture industrielle peuvent causer, en plus des extinctions, des bouleversements tels que les insectes deviennent de possibles menaces.
On connaît très bien le cas du scolyte qui ravage les forêts d’épicéas, ou encore la présence de plus en plus fréquente du moustique-tigre, mais il en est d’autres qui sont étudiés et surveillés par l’Agence régionale de santé. Le Plan régional santé-environnement 2023-2027 en Bourgogne-Franche-Comté prévoit notamment « de mieux connaître et prioriser les zoonoses (pathologies transmissibles naturellement entre humains et animaux vertébrés) et les maladies vectorielles (pathologies transmises par l’intermédiaire d’insectes ou de tiques par exemple, qui se nourrissent de sang) ».
Que peut-on faire pour enrayer ce déclin ?
Les actions à échelle individuelle ou collectives sont possibles et facilement réalisables :
-
au jardin, on évitera d’utiliser des insecticides, et on laissera des zones non tondues qui serviront de refuges aux insectes, en plus de procurer de la fraîcheur au sol en été ;
-
on sème des fruits et des légumes bio au potager et on s’efforce de planter des espèces locales ;
-
on renonce à brûler ou ramasser les feuilles mortes en automne ;
-
on sème des fleurs locales mellifères ;
-
on apprend à mieux connaître les insectes pour mieux cohabiter avec eux, en rejoignant un programme de sciences participatives comme QUBS par exemple.